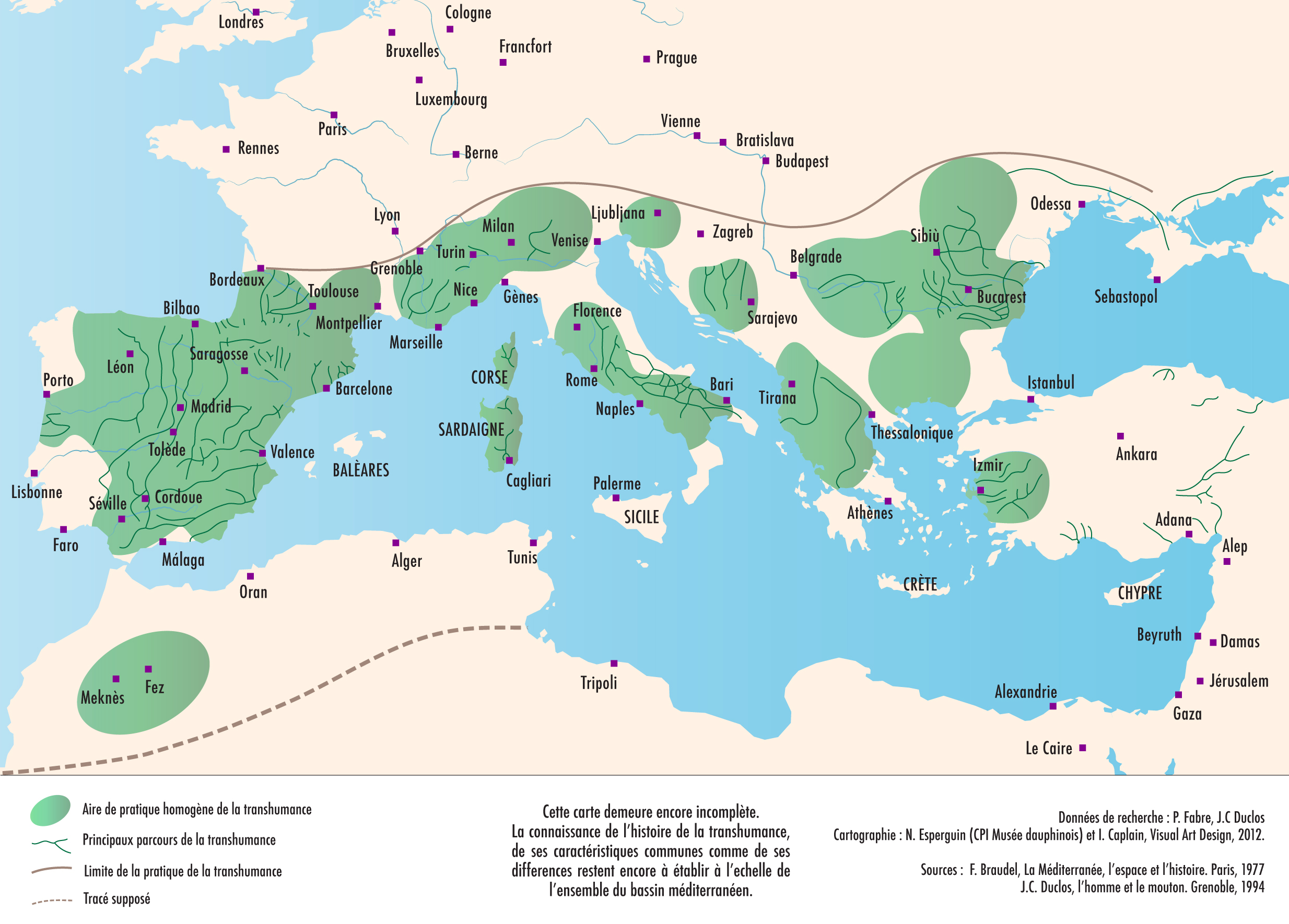Transhumances modernes
Jugé gênant pour la circulation automobile, l’acheminement des troupeaux bascula largement vers le train au début du 20e siècle, permettant d’aller jusque dans les alpages de la Haute-Savoie.
C’est ensuite le camion qui a pris le relais depuis les années 1950. De nos jours, la plupart des cheptels sont en effet transportés dans des bétaillères pouvant contenir, sur trois ou quatre étages, près de 400 têtes.
Aujourd’hui, seuls certains troupeaux, représentant environ 25 000 têtes et hivernant dans le Var, les Alpes-Maritimes ou le Sud des Alpes-de-Haute-Provence, continuent de transhumer à pied vers les vallées proches de l’Ubaye, de la Tinée ou du Verdon. La transhumance à pied y étant encore tolérée, ils empruntent les petites routes départementales et nationales, les chemins, les carraires quand elles existent encore. Les voyages, d’une distance moyenne de 200 kilomètres, durent alors de cinq à douze jours, avec un départ dans la première quinzaine de juin. Cette transhumance est réglementée, le troupeau doit être précédé et suivi de véhicules équipés de gyrophares et les bergers, leurs familles et les accompagnants doivent porter des gilets fluorescents. Aussi contraignante soit-elle, la transhumance à pied permet encore aux éleveurs d’économiser le coût du transport, d’habituer progressivement les bêtes à l’altitude, mais aussi de perpétuer une pratique ancestrale.